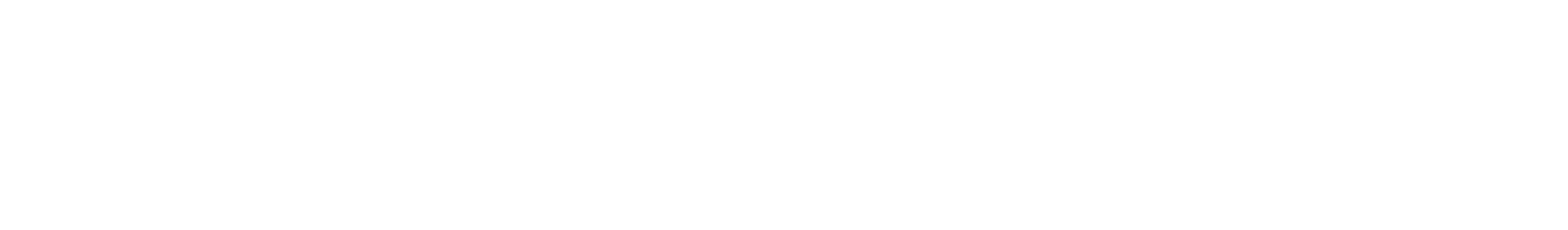Les inégalités sociales de santé se manifestent de manière significative en périnatalité. Elles touchent les femmes de façon différenciée selon leur statut socio-économique et culturel. Plusieurs études montrent que les femmes exilées, en particulier, sont confrontées à des obstacles multiples qui renforcent leur vulnérabilité (Balaam, Kingdon et Haith-Cooper 2022; Eslier et al. 2023).
S’agissant de l’accès aux soins, les femmes migrantes en situation de précarité bénéficient souvent d’un suivi prénatal moins régulier et de qualité inférieure par rapport aux femmes non migrantes (Carayol et al. 2015; Eslier et al. 2023; Philibert, Deneux‐Tharaux et Bouvier‐Colle 2008; El Kotni et Quagliariello 2021). Leurs parcours sont marqués par des défis multiples : statut juridique et socio-économique limitant l’accès aux services, mais aussi discriminations liées à l’origine et au genre, qui pèsent négativement sur leur santé (Cognet, Hamel et Moisy 2012; Virole 2022).
À ces difficultés s’ajoutent les différences linguistiques, qui peuvent entraver la qualité du suivi médical et affecter l’état de santé des patientes. En effet, la maîtrise – ou non – du français influence fortement l’attitude des professionnel·les de santé, au point parfois d’éclipser d’autres déterminants sociaux (Eberhard et Gelly 2020). Depuis 2017, la loi interdit de discriminer une personne sur un motif linguistique. Pourtant, le « linguicisme » (Skutnabb-Kangas 2015) reste peu mobilisé en France. Ce terme désigne les discriminations fondées sur la ou les langues que parlent les personnes, qu’il s’agisse de leur(s) langue(s) familiale(s) ou non, et sur la manière dont elles l’utilisent.
Cette articulation entre inégalités sociales de santé et linguicisme est au cœur de notre recherche-action.